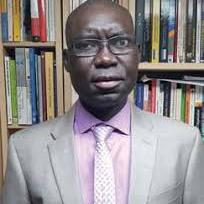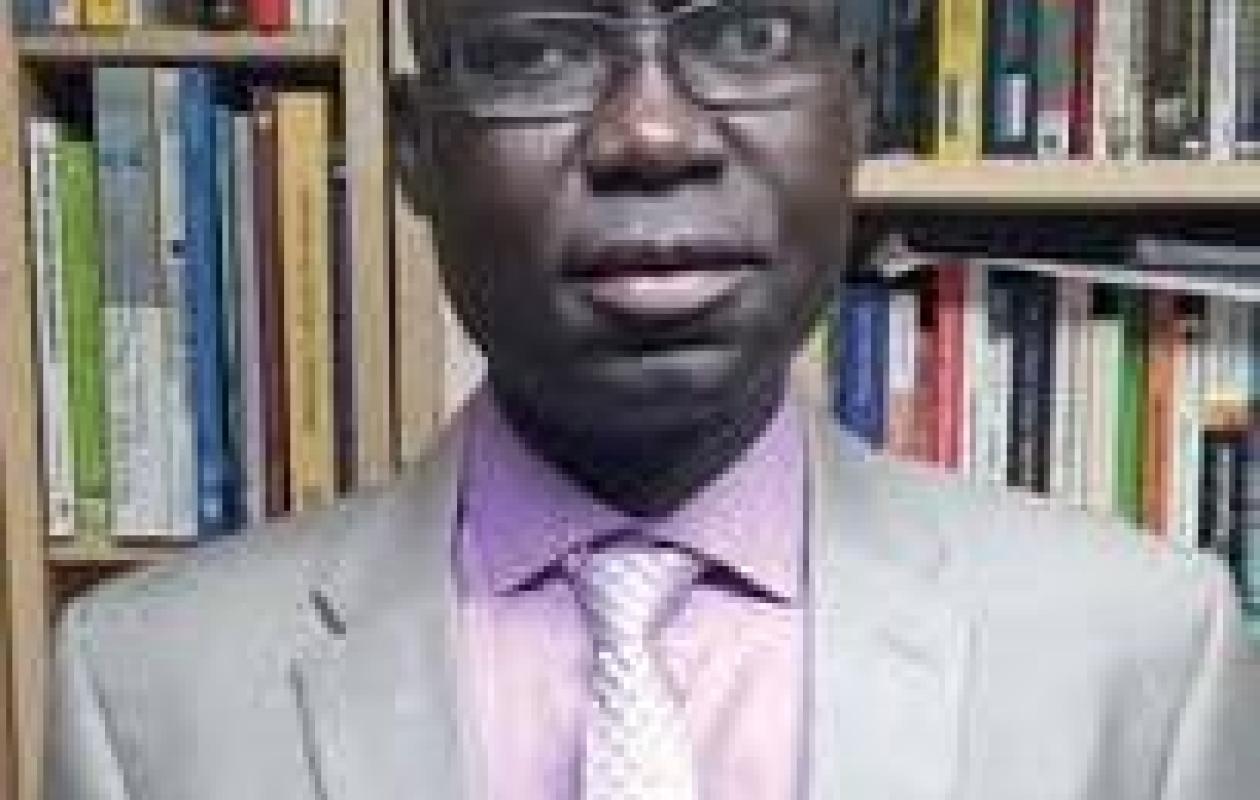
« Sortir de l’ombre : comprendre la “dette cachée” et pourquoi la transparence actuelle est une chance pour le Sénégal » (Par Pr Mamadou Vieux Lamine Sane)
Au Sénégal, le débat sur la « dette cachée » a envahi la scène publique. Beaucoup y voient un choc politique ; il faut y lire surtout une occasion historique : celle de refermer la parenthèse d’une comptabilité incomplète, de rehausser nos standards de transparence et de réinstaller la confiance entre l’État, les citoyens et les partenaires. Les faits sont têtus : à la faveur d’audits et d’exercices de réconciliation des chiffres, les autorités et les institutions financières internationales ont reconnu que des engagements publics importants n’avaient pas été correctement reportés auparavant, forçant une révision substantielle du stock de dette. L’important, désormais, n’est pas d’entretenir le procès en sorcellerie, mais d’expliquer ce qui s’est passé, de documenter la réponse en cours et d’indiquer pourquoi cette clarification, conduite par le gouvernement actuel, est saine pour l’économie et la démocratie sénégalaises.
1) D’abord, les faits : de quoi parle-t-on quand on parle de « dette cachée » ?
Dans la comptabilité publique moderne, la dette ne se limite pas aux emprunts directs du Trésor. Elle inclut des passifs contingents (garanties), des arriérés, des engagements contractés par des entreprises publiques, parfois consolidés par l’État, et des financements hors-bilan. C’est précisément là que le bât a blessé : une partie des engagements pris les années précédentes a été sous-déclarée ou mal ventilée, et le stock de dette du gouvernement central a dû être révisé à la hausse après un exercice d’audit et de réconciliation externe (Forvis Mazars), exercice que l’IMF a entériné dans ses communications récentes. L’institution a évoqué des « passifs précédemment non divulgués » et des niveaux de dette supérieurs aux chiffres publiés auparavant, amenant à recalculer la trajectoire de finances publiques et à discuter d’un nouveau cadre de programme avec le Sénégal.
2) Pourquoi cette révision est-elle, paradoxalement, une bonne nouvelle ?
Parce qu’on ne soigne que ce que l’on nomme correctement. La reconnaissance officielle du périmètre réel de la dette n’est pas un aveu de faiblesse du pays ; c’est le point de départ d’une gouvernance plus adulte des finances publiques. D’une part, elle restaure la crédibilité statistique du Sénégal, condition sine qua non pour négocier des financements soutenables, réétaler des échéances ou mobiliser des appuis budgétaires. D’autre part, elle remet de l’ordre dans la chaîne des responsabilités : qui décide d’un engagement ? qui l’enregistre ? qui le consolide ? qui en rend compte ? Sur ces quatre questions, le gouvernement actuel a fait le choix de la lumière : audit indépendant, publication des constats, dialogue avec le FMI et les partenaires, et feuille de route de réformes en matière de reporting budgétaire, de gestion des entreprises publiques et d’intégrité des données. Les signaux envoyés par le FMI ces derniers mois – reprise des échanges en vue d’un nouveau programme, accent mis sur la transparence budgétaire – vont dans ce sens.
3) Mettons fin aux faux débats : héritage structurel, pas fatalité nationale
La tentation est grande de réduire cette séquence à une bataille de récits. Certains nient l’existence même d’une dette cachée ; d’autres surenchérissent sur des montants hors de tout contrôle. Le sérieux commande autre chose : se fier aux documents audités et aux institutions qui en ont attesté. Les analyses internationales convergent : le Sénégal a découvert en 2024–2025 un écart significatif entre dette déclarée et dette réelle, lié pour partie à des engagements consolidés après coup et à des entreprises publiques. Le débat utile n’est donc pas « y a-t-il dette cachée ? » mais « comment empêcher que cela se reproduise ? » ; non pas « qui a gagné le narratif ? » mais « quel système d’alerte met-on en place ? ». C’est exactement la ligne adoptée aujourd’hui : renforcer le contrôle interne, améliorer la gouvernance des entreprises publiques, intégrer les engagements quasi-budgétaires dans un cadre de viabilité de la dette crédible, et publier des rapports réguliers, lisibles par le Parlement et par le public.
4) Ce que fait – concrètement – le gouvernement actuel
Quatre chantiers sont en cours et méritent d’être soutenus par l’ensemble de la classe politique :
(i) Transparence et intégrité des données. Poursuite des audits, réconciliation des chiffres et publication des stocks révisés, étape validée par les équipes du FMI.
(ii) Discipline budgétaire. Lien plus étroit entre programmation pluriannuelle (CDMT) et exécution infra-annuelle, plafonds par programmes, mise sous condition de certains engagements.
(iii) Gouvernance des entreprises publiques. Exigence d’états financiers audités, plafonds d’endettement, suivi des garanties, intégration graduelle dans la dette consolidée, et revue des subventions croisés/subventions implicites (énergie, transport).
(iv) Redevabilité démocratique. Rapports de performance plus accessibles, débats parlementaires appuyés sur des indicateurs standard, et ouverture à l’audit social (médias, société civile) dans un cadre institutionnel apaisé. Ces orientations sont au cœur des échanges avec le FMI et les partenaires, lesquels saluent explicitement les avancées en matière de reporting et de transparence.
5) Pourquoi cela protège la croissance et les dépenses sociales
Le risque majeur, en cas d’opacité persistante, est la prime de risque que les marchés appliquent au pays : coûts d’emprunt plus élevés, accès réduit au financement, pressions sur le taux de change, et, in fine, arbitrages douloureux sur les dépenses sociales. L’assainissement statistique, même s’il est désagréable à court terme, est protecteur à moyen terme : il permet de reprofiler la dette, d’ajuster le calendrier des émissions, d’optimiser la part concessionnelle et de préserver les postes clés (éducation, santé, protection sociale). C’est aussi la condition pour absorber les chocs – prix de l’énergie, saisonnalité agricole – sans perdre de vue l’ambition de long terme. Les discussions en cours avec le FMI, après la période de gel intervenue à la suite du « misreporting », s’inscrivent précisément dans cette logique de retour à un ancrage macro-budgétaire crédible.
6) Un mot sur la pédagogie publique
On ne gagnera pas la bataille de la confiance uniquement avec des tableaux Excel. Trois gestes politiques comptent :
.Parler vrai : expliquer simplement la différence entre dette budgétaire, dettes consolidées des entreprises publiques, garanties et arriérés ; dire ce qui a été découvert, ce qui a été corrigé et ce qui reste à faire.
.Ritualiser la redevabilité : publier des bulletins trimestriels synthétiques, comparables dans le temps, que journalistes, députés et citoyens puissent suivre ; tenir des conférences de presse budgétaires régulières.
.Protéger l’équité : assortir la consolidation de garde-fous sociaux et éducatifs, en ciblant mieux les subventions et en préservant les programmes à fort effet d’apprentissage (lecture/numératie, cantines, bourses ciblées).
Cette pédagogie est d’ailleurs encouragée par les évaluations internationales de transparence fiscale, qui soulignent l’importance de publier des audits et d’ouvrir les données budgétaires au public.
7) La meilleure défense : faire mieux, tout de suite
Défendre l’action actuelle ne consiste pas à blanchir le passé, mais à démontrer que nous apprenons de cette séquence : auditons, corrigeons, publions, réformons. Le gouvernement a choisi ce chemin de responsabilité. Les citoyens doivent l’exiger de tous les gouvernements à venir, quels qu’ils soient. Car une vérité simple s’impose : la dette la plus dangereuse est celle que l’on ne voit pas. En la faisant apparaître, en la cartographiant et en la gérant à ciel ouvert, le Sénégal se donne les moyens de protéger sa souveraineté financière, de sécuriser l’investissement social et d’orienter l’épargne nationale vers la productivité plutôt que vers le doute.
Pour conclure : ce débat n’oppose pas patriotes et détracteurs ; il distingue les cultures de gouvernance. La nôtre doit préférer la preuve au mythe, la prévention au déni, la redevabilité à l’opacité. En assumant la vérité des chiffres et en corrigeant les règles du jeu, le Sénégal fait un choix exigeant et salutaire. C’est ce choix que le gouvernement actuel met en œuvre. Notre responsabilité collective est de l’y encourager, pour que la prochaine controverse sur la dette n’ait tout simplement plus lieu d’être.
Pr Mamadou Vieux Lamine Sane, Ph.D. en sciences de l’éducation
Diplômé de l’école nationale d’administration publique du Québec
(ENAP-Montréal)